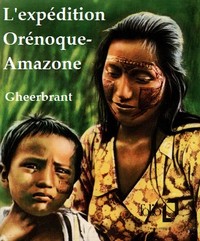Présentation
L'Expédition Orénoque-Amazone est le récit par Alain Gheerbrant d'une aventure hors du commun, entreprise avec son équipe entre 1949 et 1950.
De cet ouvrage "fleuve", j'ai extrait 99 citations afin d'illustrer autant de mots du dictionnaire, parmi lesquels, forêt tropicale oblige, fourmillent les noms d'animaux. J'en ai d'ailleurs rassemblés certains dans un modeste trombinoscope (voir ci-dessous).
Au contraire, les termes de végétaux ne sont pas légion ; on se contentera de manioc, d'igname et d'hévéa. La végétation est plutôt à considérer comme un tout. Saviez-vous que dans certaines langues d'Amérique du Sud, la notion d'ancêtre englobe aussi les plantes ? L'homme et son environnement ne font qu'un, au point que la notion même d'environnement n'existe pas vraiment. Les Indiens connaissent très bien les plantes qui peuplent leur forêt. Ils en tirent de quoi se nourrir et de quoi fabriquer toute sorte de choses (du sac à dos à la pirogue).
Les premières citations de L'Expédition Orénoque-Amazone ne comptent pas parmi les plus dépaysantes. Elles concernent en effet le tout début du voyage, dans les llanos, quand la machette (à écrire machete et à prononcer à l'espagnole "match et thé") n'est pas encore un objet familier. Ensuite c'est la forêt, et les rencontres marquantes avec plusieurs tribus, leurs coutumes, leurs croyances, leurs rites spécifiques. Elles se nomment Piaroas, Guaharibos, Maquiritares.
Définition du vocabulaire peu courant
Informations
Les numéros de page correspondent à l'édition suivante :
| ISBN | 2-07-036329-5 |
|---|---|
| Collection | Folio |
| Date d'impression | 1973 |
| Nb pages | 440 |
Infos générales sur L'Expédition Orénoque-Amazone :
| Date de parution | 1952 |
|---|---|
| Auteur | Alain Gheerbrant |
| Éditeur | Gallimard |
Trombinoscope animalier
Voici donc quelques animaux croisés (de près ou de loin) par l'équipe d'Alain Gheerbrant lors de l'expédition. On vous fait grâce des milliers de variétés d'insectes (moustiques, anophèles et autres "jejens") !
L'ouvrage fait également mention d'un "ours palmiste" :
« Hors nous, il ne semblait plus y avoir qu'un être vivant au monde : un ours palmiste, assez gros à en juger par la taille de ses empreintes. »
Malgré ses grosses pattes, ils n'a laissé aucune trace sur internet !
40 ans ont passé...
En 1992 paraît chez Gallimard une nouvelle édition de l'expédition :
Quarante ans ont passé. L'Amazonie est devenue le centre des préoccupations du nouvel ordre écologique mondial
[…]
Cette nouvelle édition redonne à lire le texte original, mais lesté de notes grâce auxquelles le lecteur s'embarque pour un double voyage dans l'Amazonie d'hier et dans celle d'aujourd'hui.
ÉCOLOGIE, le mot est lancé.
70 ans ont passé...
En 2020, l'écologie, plus que jamais sur toutes les lèvres, a un arrière-goût de pessimisme. Difficile de lire L'Expédition Orénoque-Amazone, dont l'action se déroule dans le "poumon vert" de la planète, sans songer au désastre causé par notre anthropocène. Aujourd'hui, même rouler à vélo peut nous faire sentir coupable de détruire la forêt d'Amazonie ou d'ailleurs. Vélo = pneu = caoutchouc = hévéa ! Produire toujours plus de pneus... toujours plus d'hévéas à planter, qui empiéteront sur la forêt primordiale et les cultures vivrières.
Refermons cette parenthèse désenchantée pour voir le bon côté des choses. En 2020, on est mieux loti qu'en 1992 concernant... internet ! Je ne parle pas de l'internet des Amazon (sans jeu de mot) et consorts. Mais bien de l'internet qui mène au savoir.
Ainsi, aujourd'hui, grâce à internet, tout être humain peut consulter des documents provenant directement de l'expédition de 1948 :
- Des archives sonores : chants rituels indiens et musiques.
- Des films, dont un extrait du documentaire "Des hommes qu'on appelle sauvages".
Impossible de ne pas ressentir une vive émotion en écoutant ces sons, inconnus avant que Gheerbrant et ses acolytes ne les enregistrent sur place, en 1949-1950, dans des conditions difficiles. Qu'ils nous soient parvenus tient presque du miracle. En effet, il fallut trimballer dans des caisses robustes le matériel nécessaire (magnétophone, appareil photo, caméra, bobines, bandes sonores). Du matériel fragile dont le climat hostile de la jungle réduit considérablement la durée de vie, à moins d'utiliser des techniques appropriées d'étanchéification des contenants, en les scellant avec de la paraffine par exemple.
Ces caisses furent transportées à dos d'hommes ou bien sur des pirogues. Mais lorsque les rapides de la rivière se montrèrent trop violents, la question de sacrifier du matériel devint vitale. Mais lequel ? Cette scène est relatée dans la dernière partie du livre. Gheerbrant en vient à la conclusion que pour lui le plus important à conserver, ce sont les 2000 pages de notes rédigées au cours de l'expédition. Notes sans lesquelles cet ouvrage unique n'aurait peut-être pas existé.
- MACHETTE
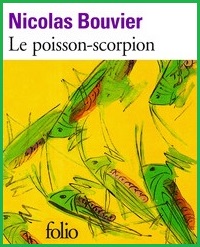
- Le Poisson-Scorpion
- 1982
- Nicolas Bouvier